La trypanosomiase (Maladie du sommeil)

La trypanosomiase humaine africaine, plus communément appelée maladie du sommeil, est une parasitose potentiellement mortelle transmise par la mouche tsé-tsé. Endémique dans certaines régions d'Afrique subsaharienne, cette maladie négligée représente un problème majeur de santé publique dans les zones rurales.
Définition et épidémiologie
La trypanosomiase humaine africaine (THA) est une maladie parasitaire causée par des protozoaires du genre Trypanosoma. On distingue deux formes principales :
- Trypanosoma brucei gambiense : responsable de 98% des cas, forme chronique en Afrique de l'Ouest et centrale
- Trypanosoma brucei rhodesiense : forme aiguë en Afrique de l'Est et australe
Selon l'OMS, environ 65 millions de personnes sont exposées au risque d'infection dans 36 pays d'Afrique subsaharienne. Le nombre de nouveaux cas a considérablement diminué ces dernières années grâce aux efforts de contrôle, passant de plus de 30 000 cas en 1998 à moins de 1 000 cas en 2019.
Mode de transmission
La transmission se fait principalement par la piqûre de la mouche tsé-tsé (Glossina spp.), insecte hématophage qui acquiert le parasite en se nourrissant sur un hôte infecté (humain ou animal). D'autres modes de transmission plus rares existent :
- Transmission mère-enfant (transplacentaire)
- Transmission par aiguilles contaminées
- Transmission sexuelle (exceptionnelle)

Symptômes et évolution
Phase hémolymphatique (première phase)
Les symptômes apparaissent généralement 1 à 3 semaines après l'infection pour T.b. rhodesiense et plusieurs mois à un an pour T.b. gambiense :
- Chancre trypanosomien (lésion cutanée au point d'inoculation)
- Fièvre irrégulière
- Adénopathies (ganglions enflés, surtout cervicales)
- Douleurs musculaires et articulaires
- Prurit (démangeaisons)
- Asthénie (fatigue intense)
Phase neurologique (seconde phase)
Le parasite traverse la barrière hémato-encéphalique et envahit le système nerveux central :
- Troubles du sommeil (inversion du rythme nycthéméral)
- Troubles du comportement (agitation, irritabilité ou apathie)
- Troubles moteurs (marche chancelante, tremblements)
- Confusion mentale
- Convulsions
- Coma et décès en l'absence de traitement
La maladie est toujours mortelle en l'absence de traitement. La forme rhodesiense évolue plus rapidement (quelques semaines ou mois) tandis que la forme gambiense peut durer plusieurs années avant d'aboutir au décès.
Diagnostic
Le diagnostic repose sur plusieurs méthodes complémentaires :
Diagnostic parasitologique
- Examen microscopique du chancre, du sang, du liquide lymphatique ou du LCR
- Techniques de concentration (centrifugation, colonne échangeuse d'anions)
- PCR (technique moléculaire) dans les laboratoires spécialisés
Diagnostic sérologique
Particulièrement utile pour le dépistage de T.b. gambiense :
- CATT (Card Agglutination Test for Trypanosomiasis)
- Tests rapides (ex : HAT Sero-K-SeT)
- ELISA et immunofluorescence
Examens complémentaires
- Ponction lombaire pour analyse du LCR (cellules, protéines, trypanosomes)
- Numération formule sanguine (anémie, leucocytose)
- Bilan hépatique (élévation des transaminases)
- IRM cérébrale (dans les formes neurologiques avancées)

Traitement
Le traitement dépend de la forme de la maladie et du stade évolutif :
Traitement de la première phase
- Pentamidine : pour T.b. gambiense, administrée par injections intramusculaires pendant 7 jours
- Suramine : pour T.b. rhodesiense, administrée par voie intraveineuse
Traitement de la deuxième phase
- Mélarsoprol : dérivé arsenical très efficace mais toxique (encéphalopathie dans 5-10% des cas)
- Eflornithine : moins toxique mais schéma thérapeutique complexe (perfusions toutes les 6h pendant 14 jours)
- Nifurtimox-eflornithine combinaison thérapeutique (NECT) : traitement de référence actuel pour T.b. gambiense
- Fexinidazole : nouveau traitement oral approuvé en 2018 pour les deux stades de T.b. gambiense
Le traitement doit toujours être administré sous surveillance médicale stricte en milieu hospitalier. Un suivi du patient est nécessaire pendant 24 mois pour détecter d'éventuelles rechutes.
Prévention et contrôle
Plusieurs stratégies sont employées pour lutter contre la maladie du sommeil :
Prévention individuelle
- Port de vêtements couvrants (couleurs claires, tissus épais)
- Utilisation de répulsifs contre les insectes (DEET, perméthrine)
- Éviter les zones infestées par les glossines
- Dépistage précoce en cas de suspicion
Lutte vectorielle
- Piégeage des mouches tsé-tsé (pièges imprégnés d'insecticides)
- Pulvérisations d'insecticides
- Modification de l'environnement (débroussaillage des berges)
- Technique de l'insecte stérile dans certaines zones
Stratégies communautaires
- Dépistage actif des populations dans les zones endémiques
- Surveillance épidémiologique
- Formation du personnel de santé
- Sensibilisation des populations à risque
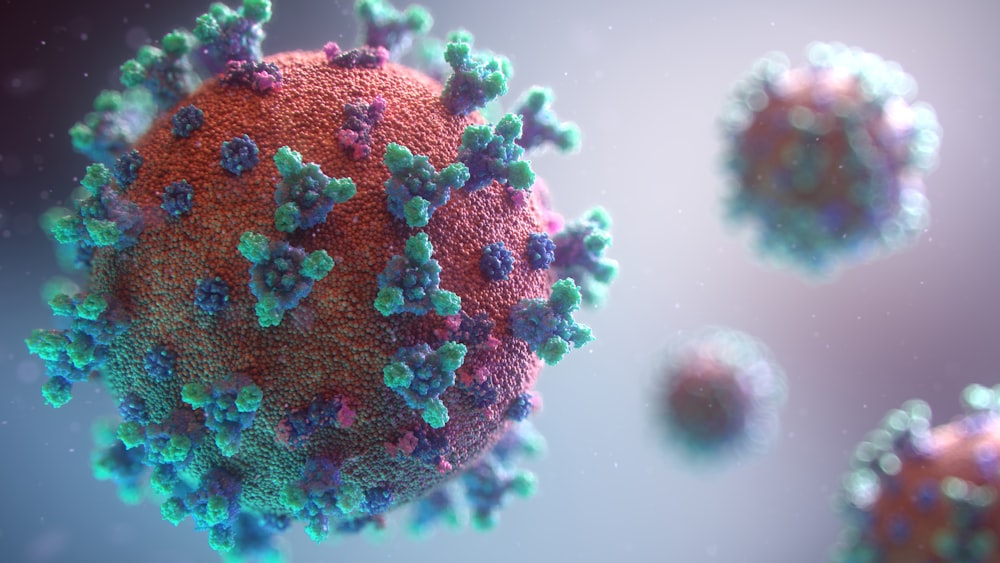
Pronostic et complications
Avec un diagnostic précoce et un traitement approprié, le pronostic est généralement bon. Cependant, plusieurs complications peuvent survenir :
- Séquelles neurologiques dans les formes avancées (troubles psychiatriques, paralysies)
- Effets secondaires des traitements (toxicité du mélarsoprol, hypotension avec la pentamidine)
- Décès dans 100% des cas non traités
- Rechutes possibles nécessitant un nouveau traitement
Conseils et recommandations
Pour les voyageurs se rendant dans les zones endémiques :
- Consulter un médecin spécialisé en médecine des voyages avant le départ
- Se renseigner sur les zones à risque actuelles
- Éviter les activités en bordure de rivière ou en forêt aux heures d'activité des glossines
- En cas de fièvre au retour ou dans les mois suivants, consulter immédiatement en mentionnant le voyage
Pour les populations vivant en zone endémique :
- Participer aux campagnes de dépistage organisées
- Consulter rapidement en cas de symptômes évocateurs
- Utiliser les moyens de protection disponibles (moustiquaires, pièges)
- Éviter les contacts avec les réservoirs animaux (bétail, faune sauvage)
Sources et références :
- Organisation Mondiale de la Santé (OMS) - Fiche technique sur la trypanosomiase humaine africaine (2022)
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC) - African Trypanosomiasis
- MSF - Guide pratique de la maladie du sommeil (2018)
- Institut Pasteur - Dossier trypanosomiase africaine
- Journal of Tropical Medicine - Advances in HAT Diagnosis and Treatment (2021)
Images libres de droit provenant de Unsplash
